Bienvenue sur le site d'information et de services de l'Urssaf
Attention aux arnaques !
Les risques de fraude sont nombreux, soyez vigilants. L’Urssaf ne vous demande jamais vos coordonnées bancaires ou mot de passe par téléphone ou par mail. En cas de doute, contactez-nous via votre espace en ligne. Pensez également à modifier régulièrement votre mot de passe.
En savoir plusQue souhaitez-vous faire ?
Actualités
-

L'Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants touchés par des intempéries
Mis à jour le 25 juillet 2024
- Actualité
- Artisan-commerçant
- Employeur
-

Découvrez notre assistant vocal dédié aux employeurs
Publié le 22 juillet 2024
- Actualité
- Employeur
-

Un montant net social correctement déclaré, c’est essentiel !
Publié le 19 juillet 2024
- Actualité
- Employeur
- Expert-comptable
-

L'Urssaf vous accompagne pour éviter les arnaques
Mis à jour le 15 juillet 2024
- Actualité
- Tout public
Taux et barèmes
Consultez tous les taux et barèmes à jour pour calculer vos cotisations.
1er juillet 2024
AGS 0,25 % taux de cotisation patronale d’assurance garantie des salaires (AGS)
Services de l'Urssaf
-
Première embauche
Service
Première embauche, un service de l’Urssaf pour guider les nouveaux employeurs dans leurs démarches.
- Employeur
-
Cesu
Service
Le Cesu, un service de l’Urssaf qui simplifie et facilite la vie quotidienne des particuliers employeurs et des salariés à domicile.
- Particulier employeur
- Salarié du particulier employeur
-
Mes premiers mois avec l’Urssaf
Service
Un accompagnement tout au long des étapes clés de votre première année d’entrepreneuriat, pour réussir le lancement de votre entreprise.
- Artisan-commerçant
- Auto-entrepreneur
-
Mobilité internationale
Service
Avec le service Mobilité internationale, l’Urssaf vous accompagne dans vos démarches lors de déplacements professionnels à l’étranger.
- Tout public
On vous recommande
-
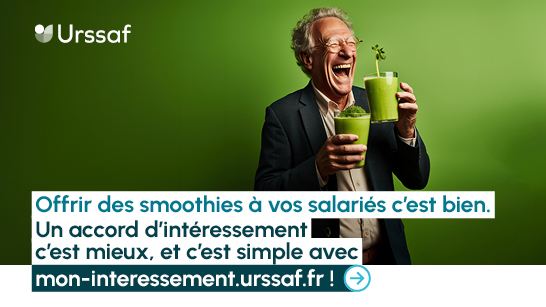
Vous souhaitez mettre en place un accord d'intéressement ? Plus d'information sur notre site dédié.
-

Réalisez vos formalités de création ou de modification d’entreprise sur le site du guichet unique.
-
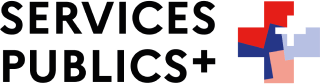
Découvrez les engagements pour des services publics plus proches, plus simples et plus efficaces.
Votre Urssaf de proximité
Accédez à l'information et à l'actualité de votre Urssaf régionale.
Sélectionnez votre région
Découvrir l'Urssaf et son rôle au service de la protection sociale
Que vous soyez partenaires, journalistes, investisseurs, candidats, ou que vous souhaitiez tout simplement en savoir plus sur nous, nos missions, nos valeurs.
Découvrir l'UrssafAbonnez-vous à la lettre d'information Urssaf
Vous êtes employeur, indépendant, particulier, l'Urssaf propose tous les mois des lettres d'information adaptées à vos besoins.
S'abonner